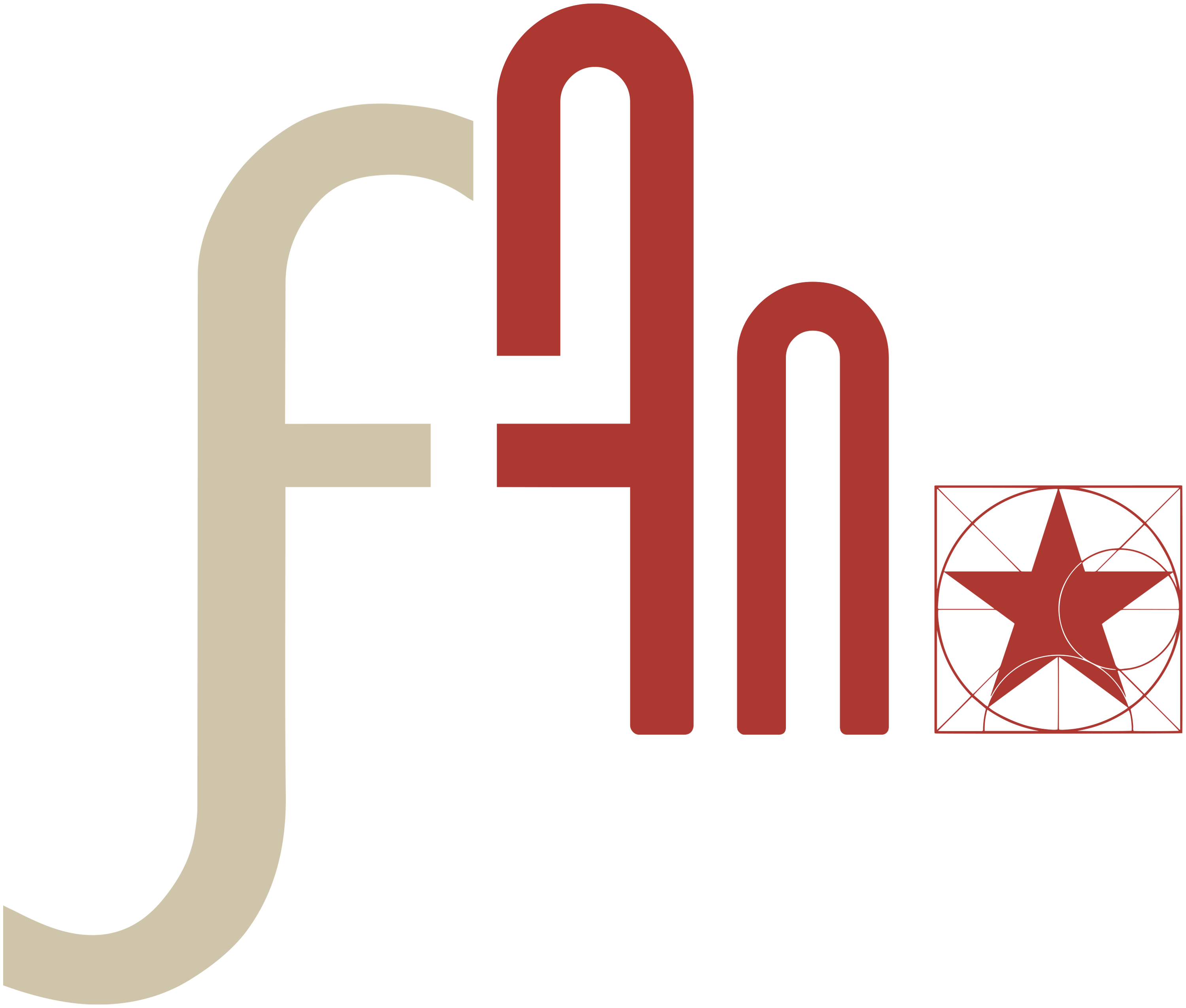A review by Vera Chentsova (EPHE-PSL)
Ivan Foletti, L’imperialismo russo e il mito di Bisanzio (2025)

Ivan Foletti, L’imperialismo russo e il mito di Bisanzio. Arte, scienza e religione al servizio del potere (1801-2025), Roma : Viella, 2025 (La storia. Temi, 127). 116 p., ill.
La chute en 1453 de Constantinople, capitale byzantine, ne mit pas fin à la fascination exercée par cet « Empire romain d'Orient », qui demeura des siècles durant un modèle de civilisation. Son prestige reposait à la fois sur son raffinement culturel, son extension territoriale et sa capacité à l’acculturation des peuples voisins, auxquels l’empire transmit la religion chrétienne dans son acception orthodoxe. C’est l’Église orthodoxe qui en premier lieu contribua à la perpétuation de l’idéal impérial que l’on exprime par la formule « Byzance après Byzance ».
Le cas russe est particulièrement significatif de ce processus d’appropriation du passé impérial byzantin. Dans sa récente publication Ivan Foletti s’intéresse à l’évolution du « mythe de Byzance » en Russie depuis l’époque impériale jusqu’aux périodes soviétique et contemporaine. Ce mythe s’enracine dans la longue lutte des souverains de Moscovie pour être reconnus comme successeurs des empereurs byzantins et faire de leur capitale la « Troisième Rome », héritière légitime de Rome et Constantinople. Pour mener son enquête, Foletti adopte un angle spécifique : il examine la manière dont ce mythe de la grandeur impériale s’est exprimé dans l’architecture et l’art. Il analyse notamment l’émergence, au XIXe siècle, de grandes cathédrales de style néo-byzantin ou russo-byzantin dédiées au saint prince Alexandre Nevski. Elles furent érigées dans les territoires annexés par les tsars ou placés sous l’influence politique de la Russie (Pologne, Géorgie ou Bulgarie). Certaines de ces églises furent abattues après la Révolution de 1917 en tant que symboles de l’incorporation forcée à l’espace impérial. Toutefois, l’époque stalinienne marqua un retour à l’instrumentalisation de la figure héroïque du prince Alexandre Nevski, dont la popularité fut largement renforcée par le film culte d’Eisenstein (1938).

La cathédrale des Forces armées russes, inaugurée en 2020, s’inscrit dans ce continuum historique, perpétuant la vénération des saints militaires et soulignant la continuité historique des victoires russes. Elle se présente explicitement comme un monument commémoratif de la victoire dans la « Grande Guerre patriotique », appellation consacrée en Russie pour désigner la Seconde Guerre mondiale, et se situe ainsi dans la filiation directe de la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou, édifiée en mémoire du salut de la Russie face à l’armée napoléonienne lors de la guerre de 1812. On s’éloigne ainsi d’une spiritualité héritée de Byzance pour se rapprocher davantage d’une culture religieuse inspirée de la Rome antique et de son culte de la Victoire et des triomphes militaires.
Le livre d’Ivan Foletti ouvre un vaste champ de réflexion, montrant que l’incarnation du mythe impérial ne suit nullement une trajectoire linéaire. L’auteur souligne comment la fascination exercée par Byzance a pu se transformer en glorification de son héritière, « la Sainte Russie ». Selon les historiens de l’art de l’époque stalinienne, l’art byzantin, critiqué pour sa supposée « rigidité », ne trouva un plein épanouissement que dans un cadre « national » russe. On relève par ailleurs dans le livre de Foletti un cas qui mérite une réflexion ultérieure : bien que saint Alexandre Nevski soit représenté dans un cadre imprégné de symboles byzantins, il fut canonisé et glorifié au XVIe siècle, époque marquée par la rupture de Moscou avec l’Église constantinopolitaine. La Russie se présente ainsi comme la réincarnation de Byzance, assumant la fonction de véritable « Troisième Rome » et revendique de porter à son point d’orgue l’universalisme impérial de matrice romano-byzantine.
Dans cette logique, le président Vladimir Poutine, qui siège aujourd’hui sous les armoiries impériales à l’aigle bicéphale, n’apparaît pas seulement comme un imitateur des empereurs byzantins, mais comme celui qui porte à terme leur mission dans une version spécifiquement russe : celle de la « Troisième Rome », plus glorieuse encore que les précédentes, et dont l’éternité revendiquée postule qu’il ne saurait y avoir de « Quatrième Rome ». C’est ainsi que, selon Foletti, le discours officiel de l’État russe, qui mobilise pour ce faire une mémoire historique spécifique, se structure en louvoyant entre les images qu’évoquent les deux « Romes » et la « Sainte Russie » médiévale et promeut ainsi l’idée d’un « Empire universel » réincarné en Russie.
Vera Chentsova, Maître de conférences et titulaire de la chaire Orthodoxie slave à l'EPHE-PSL.
Pour approfondir :
Stefano Caprio, La nuova sinfonia : il trono e l’altare nella Russia post-comunista, Religione e potere. L’opportunità che diviene tentazione, a cura di Silvano Petrosino, Milano : Jaca Book, 2018, p. 123-139.
Angelica Carpifave, Dalla Santa Russia a Putin. Nazionalismo e religione, Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna, 2016.
Martin C. Putna, Rus – Ukraine – Russia: Scenes from the Cultural History of Russian Religiosity, Prague : Karolinum Press, 2021 (Václav Havel Series).
Silvia Ronchey, L’aquila a due teste. Putin e il fantasma di Bisanzio, Bisanzio e l’Europa. Attualità di un passato, a cura di Federico Marazzi, Milano : FrancoAngeli, 2024 (Culture artistiche del Medioevo), p. 115-139.
Illustrations : Moscou, cathédrale des Forces armées russes (cathédrale de la Résurrection du Christ), Koubinka (2020). Vue de l'intérieur. Photographie : Camille Lacour.